Écrire sur des sujets sensibles : ce que dit la loi en France et au Québec
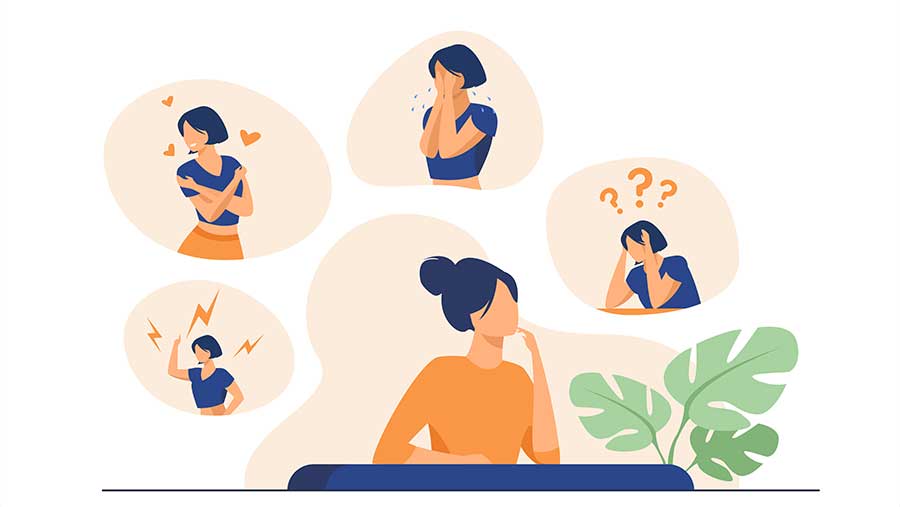
Quand on débute dans l’écriture – et plus encore lorsque l’on observe les polémiques et scandales qui éclatent régulièrement sur les réseaux sociaux – une question revient de manière obsessionnelle : a-t-on le droit d’écrire sur tout ? Peut-on aborder des sujets sensibles sans risquer des conséquences juridiques réelles ?
En 2020, nous avions déjà exploré ces interrogations sous l’angle culturel et social avec les articles Qui a le droit d’écrire quoi et Être un.e auteur.e à l’ère du « politiquement correct ».
Ici, l’objectif est différent : il s’agit d’un article strictement juridique, destiné à répondre à une question précise et légitime : ce que j’écris peut-il me causer légalement du tort ?
Sommaire
- Écrire sur des sujets sensibles : liberté de création et cadre légal
- Liberté d’expression et liberté artistique : ce que garantit la loi
- Écrire sur des sujets sensibles : les interdits légaux absolus
- Ce qui reste parfaitement légal en fiction
- Utiliser des personnes réelles en fiction : cadre juridique
- Les erreurs courantes qui exposent à un risque juridique
- Diffamation, caricature et stéréotypes : une zone de vigilance
- Écrire sur des sujets sensibles à l’international
- FAQ : écrire sur des sujets sensibles et la loi
- À retenir
Cette inquiétude est particulièrement forte chez les primo-auteur·ices et chez celles et ceux qui abordent des thématiques sensibles : Shoah, esclavage, colonisation, génocides, violences systémiques, religions, terrorisme, discriminations, etc.
Attention toutefois : les débats sur les réseaux sociaux ne constituent aucune source juridique fiable. Seules la loi, la jurisprudence et l’analyse de professionnel·les du droit permettent de déterminer ce qui est légal ou non.
Cet article n’a pas pour but de vous dire quoi écrire, mais de clarifier précisément ce que la loi autorise et ce qu’elle interdit réellement en France et au Québec. Avant de s’autocensurer par peur, mieux vaut connaître les vraies frontières juridiques… et l’étendue réelle de la liberté de création.
Écrire sur des sujets sensibles : liberté de création et cadre légal
Aborder un sujet sensible en fiction n’est jamais neutre. La littérature touche à l’Histoire, à la mémoire collective, aux blessures encore ouvertes. C’est précisément pour cette raison que le droit encadre la création artistique, sans pour autant l’étouffer.
Contrairement à une idée répandue, la loi ne classe pas les sujets comme « autorisés » ou « interdits ». Elle fixe des limites très précises, applicables quel que soit le thème traité.
Liberté d’expression et liberté artistique : ce que garantit la loi
En France, la liberté d’expression et de création artistique repose sur plusieurs textes fondamentaux :
- La Constitution et le Préambule de 1946.
- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 11.
- La Convention européenne des droits de l’homme, article 10.
Au Québec, cette liberté est protégée par :
- La Charte canadienne des droits et libertés (article 2b).
- La Charte des droits et libertés de la personne du Québec (article 3).
Dans les deux systèmes, ces textes protègent explicitement la création artistique : romans, nouvelles, scénarios, théâtre, poésie, essais narratifs.
En droit, la liberté est le principe. Les interdictions sont des exceptions strictes, interprétées par les tribunaux.
Autrement dit, la loi ne dit jamais ce que vous devez écrire. Elle définit uniquement ce que vous n’avez pas le droit d’écrire.
Écrire sur des sujets sensibles : les interdits légaux absolus
En France comme au Québec, un auteur peut aborder n’importe quel contexte historique ou social, y compris les plus douloureux, à condition de ne pas franchir certaines lignes rouges juridiques.
Le négationnisme
Il est interdit de contester, minimiser ou relativiser l’existence de crimes contre l’humanité reconnus par la loi ou par une juridiction internationale.
- France : Loi Gayssot (1990).
- Canada : Code criminel, article 319 (modifié en 2022).
Raconter ces événements dans une fiction est légal si l’œuvre ne cautionne pas ces propos et les replace clairement dans un cadre narratif critique ou historique.
L’incitation à la haine ou à la violence
Sont interdits les écrits qui appellent explicitement à la haine, à la discrimination ou à la violence envers un groupe protégé (origine, religion, orientation sexuelle, identité de genre, handicap, sexe).
Mettre en scène un personnage haineux est légal si le récit ne transforme pas ces propos en message idéologique validé.
L’apologie de crimes
La loi interdit de présenter comme légitimes ou héroïques les crimes contre l’humanité, crimes de guerre, actes terroristes ou crimes graves.
Un roman peut toutefois adopter le point de vue d’un criminel, tant que le texte ne valorise pas ses actes.
La diffamation
La diffamation consiste à attribuer publiquement à une personne identifiable un fait précis portant atteinte à son honneur.
Critiquer une idéologie ou un système est légal. Accuser une personne réelle d’un crime fictif ne l’est pas.
Ce qui reste parfaitement légal en fiction
La fiction bénéficie d’une grande latitude. Elle peut représenter des idéologies condamnables, des personnages violents ou immoraux, des contextes historiques traumatiques, sans que l’auteur n’y adhère.
Pour rester dans un cadre légal :
- Identifier clairement l’œuvre comme fiction.
- Ne pas cautionner explicitement les propos problématiques.
- Respecter les faits historiques établis lorsqu’ils sont utilisés.
Utiliser des personnes réelles en fiction : cadre juridique
Les personnages historiques peuvent être utilisés librement, sous réserve de ne pas tomber dans le négationnisme ou l’apologie.
Les personnalités publiques vivantes peuvent être évoquées dans leur rôle public, sans leur attribuer de faits diffamatoires.
Les personnes privées bénéficient d’une protection renforcée : dès lors qu’elles sont identifiables, le risque juridique est réel.
Les erreurs courantes qui exposent à un risque juridique
- Employer un vocabulaire minimisant involontairement des crimes reconnus.
- Laisser planer une ambiguïté entre la voix du narrateur et celle de l’auteur.
- Présenter des faits historiques établis comme de simples opinions.
Diffamation, caricature et stéréotypes : une zone de vigilance
Les stéréotypes ne sont pas interdits en soi, mais ils exposent à des risques d’image et, dans certains cas, à des actions civiles si une personne ou un groupe identifiable est visé.
Écrire sur des sujets sensibles à l’international
La liberté d’expression varie fortement selon les pays. Ce qui est légal en France ou au Québec peut être interdit ailleurs, notamment dans des États à faible liberté d’expression.
En France, le principe reste clair : écrire sur des sujets sensibles est légal tant que l’on respecte les limites prévues par la loi.
Cela n’empêche ni la critique, ni la polémique, ni les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, comme expliqué ici : auteurs problématiques, boycott, censure et harcèlement .
FAQ : écrire sur des sujets sensibles et la loi
Puis-je utiliser un homme politique réel dans un roman ?
Oui, dans son rôle public. Non si vous lui inventez un crime.
Puis-je écrire une romance avec une célébrité vivante ?
Oui, si le traitement est clairement fictionnel et non diffamatoire.
Puis-je m’inspirer d’une personne réelle ?
Oui, si elle n’est pas identifiable. Sinon, le risque juridique existe.
À retenir
-
Écrire sur des sujets sensibles est légal en France et au Québec
-
La loi sanctionne les propos, pas les thèmes
-
Le négationnisme, l’apologie et la diffamation restent interdits
-
La fiction bénéficie d’une large protection juridique
